16/04/2017
"Vieux Coeur en voyage" (recension, Le Journal, 21 avril 1942)
Le Journal, 21 avril 1942
UN UNIVERS EN TROIS CENTS PAGES
"Vieux cœur en voyage" de Hans Fallada le romancier mecklembourgeois
Le public français a fait connaissance avec Hans Fallada lorsqu’on lui a présenté l’épais roman intitulé Loup parmi les loups. Mme Edith Vincent a maintenant traduit un autre ouvrage de Fallada, ce Vieux cœur en voyage, véritable chef-d’œuvre romanesque. (Éditions Sorlot.)
Hans Fallada est né en 1893, à Greiswald, dans le Mecklembourg, d’un père magistrat. Son enfance et sa jeunesse furent celles de bon nombre d’écrivains : quelques maladies, un état de fragilité prédisposant au rêve, à la lecture, à la solitude.
Des études quelque peu incohérentes furent suivies d’échecs aux examens de fin d’années. Les parents de Fallada retirèrent leur fils du collège et le mirent au travail de la terre. « Or, nous dit Alphonse de Châteaubriant, la terre lui fut une révélation exaltante et grandiose, car là, il ne rêvait plus jamais. Il apprenait avec ferveur tout ce qui regardait La vie des champs. »
Sans autorité sur les ouvriers agricoles, Fallada fut contraint d’abandonner ses fonctions d’inspecteur des domaines. Il mena, dès ce moment, une vie quelque peu errante, au hasard des gagne-pain et des besognes proposées.
***
L’œuvre de Fallada se compose aujourd’hui de quelques volumes, puissamment construits, écrits dans un style, robuste où coule une sève active et généreuse. Le public allemand a observé l’évolution de Fallada avec un grand intérêt. Il accueillit favorablement, en 1931, le premier livre de Fallada, Paysans, Bombes et Bonzes, et depuis lors, il manifeste à Fallada un attachement de plus en plus marqué. Paysans, Bombes et Bonzes fut suivi de Petit Homme et maintenant, qui connut la célébrité, de Celui qui a mangé une fois dans l’écuelle de fer blanc, de Nous avons eu un enfant, publié en 1934, et de Loup parmi les Loups.
Félis Riemkasten, dans une notice qu’il a écrite sur Fallada, s’exprime ainsi à son sujet : « Fallada ne se préoccupe pas de théories ; les cafés de littérateurs ne l’intéressent pas. C’est un homme des champs et il vit au Mecklembourg dans un très petit village. Il mène là une existence de paysan et met son point d’honneur à produire ponctuellement les tout meilleurs fruits et les tout meilleurs légumes. Sa tâche est de pouvoir bien écouter sans parler lui-même beaucoup. C’est ainsi que s’ouvrent à lui âmes et destinées, mais se découvrent aussi ruses et stratagèmes, grandeurs et petitesses, tout ce qui est humain en un mot ; et cela se rassemble en lui et il le crée en forgeron qui forge de la vie. Il a le don de pêcher de la grâce et de la beauté dans la mer de la bassesse quotidienne, grande et petite, et il sait aussi ce que la faim et la peur peuvent faire d’un homme, en dépit des meilleures intentions et des meilleurs desseins. Personne n’égale Fallada pour écrire sur la campagne et sur les paysans. Il n’écrit, en tout cas, pas suivant une formule. Il n’embellit rien dans ses livres, il ne nous ment pas, ne nous dit pas que le monde et la vie sont de toute beauté. Et, très probablement, c’est précisément parce qu’il en sait tant sur le monde qu’il a parfois détourné son regard du monde pour le porter sur le beau monde des enfants, le monde indépendant du monde.
« Les histoires d’enfants sont toujours la silencieuse exploration d’un domaine secret qui ne connait pas encore les folles règles du jeu du monde des grands. Seule la belle aurore aux doigts de rose de la vie qui commence est là. »
***
On ne peut mieux s’exprimer sur Fallada. Voyez ce roman de Vieux cœur en voyage. Il contient un univers entier en ses trois cents pages. Les « sociétés » s’y superposent. Il y a le monde de l’enfance avec sa demi-douzaine de gosses échevelés, leur reine, Rose-Marie, et leurs serments dans les vallées grises :« Moi pour toi, toi pour moi, vive Unsadel ! » (Unsadel, c’est le nom du village, un nom qui n’est point seulement un nom propre, mais qui signifie encore « Notre noblesse », de « Uns », nous, et de « Adel » noblesse.)
Il y a le monde légal, si je puis dire, celui des hommes légaux : le juge Schlulz, petit nabot à la voix d’orage, qui connaît son devoir, mais le connaît en fonction des textes de loi ; le docteur Kimmknirsch, plus proche du cœur et de ses faiblesses…
Il y a le monde des bienheureux. Hans Fallada a accompli une création étonnante lorsqu’il a tracé le visage du professeur Kitfguss. Le professeur Kitfguss, ancien maître ès religion dans un lycée de Berlin, occupe les loisirs de sa retraite à annoter la Bible. Il le fait avec pertinence. Mais, tout occupé à commenter les versets sacrés, il en a oublié la vie, les hommes. Pour son cœur, le mensonge n’existe pas plus que la méchanceté. Fallada, qui possède un certain humour, non pas tant un humour de style qu’un humour en mouvement, a donné du vieux professeur la plus parfaite image, à la fois la plus amusante et la plus attendrissante. La probité scrupuleuse de Kitfguss, son mépris de l’argent poussé jusqu’à l’oubli de l’existence de l’argent ; sa candeur, sa naïveté sont dépeints avec un sens très heureux des nuances.
Il y a enfin le monde monstrueux. Les monstres, Hans Fallada les a pris chez les paysans. Des pages de son livre, ils sortent, avec leurs traits caractéristiques, en ricanant ou en gesticulant. Le gros Tamm, le joyeux paysan d’Unsadel, qui, chaque an, donne son poids de saucisses, de boudins et de jambons aux pauvres du village. Kitfguss, quand il arriva à Unsadel, aperçut une solide poutre amarrée sur une des plus hautes branches. « Aux deux extrémités de cette poutre pendaient deux larges plateaux massifs faits de fortes branches. Sur un de ces plateaux se balançait un vigoureux paysan, formidablement gros, dont la face rouge et réjouit s’épanouissait en un rire jovial. Dans l’autre plateau, plus léger, s’élevait une montagne de saucisses fumées, de jambons crus noirâtres, de longues tranches de lard d’un beau brun doré. (Tamm) jetait des regards triomphants, autour de lui. « Vous ne le croyiez pas, hein ! gros malins ! L’an dernier, déjà, vous prétendiez que je ne pourrais plus engraisser… et j’ai tout de même engraissé ! »
Tamm est un brave homme. Tel n’est pas Schlicker, enfant bâtard, à l’âme pustuleuse, au cœur enfiévré de toutes les humeurs maléfiques. Sa femme, Mali, Mali l’épileptique, s’accouple bien à Schlicker et forme avec lui une sorte de cariatide du malheur qui s’écroulera sous le poids de ses propres poisons.
Et puis, il y a Wilhelm Gau. C’est le portrait le plus saisissant du volume :
« Un mètre quatre-vingt-six, deux quintaux, tel il était assis derrière sa table de bois blanc, dans la chambre presque sombre déjà, sans bouger, sans rien faire, regardant devant lui de ses petits yeux sombres.
« Des rides profondes sillonnaient son visage. De la racine du nez partaient des plis verticaux creusés par la réflexion, la mauvaise humeur, les soucis de l’existence et la haine des hommes.
« Il paraissait avoir, depuis sa jeunesse, lutté et médité.
« C’était vrai d’ailleurs. Il était puissant, grossier, redoutable et redouté ; en dépit de cela, il n’avait rien fait dans la vie, de ce qu’il voulait.
« Aujourd’hui encore, quand il lui fallait dire non à un acheteur, à sa femme, aux enfants, il ne disait pas seulement « Non », mais songeait :« Tout ça ne paie pas. » Et il avait raison, « tout ça », c’est-à-dire sa vie, ne l’avait pas payé ! Jamais, pas une minute, il ne l’oubliait. Il travaillait, travaillait bien, mais une fois la besogne achevée, il restait assis, sombre, les yeux perdus dans le vide.
« Devant cet homme, devant ce Wilhelm Gau, la porte s’ouvrit et ce petit voleur, ce rusé renard de Paulus Schlicker entra, un paquet sous le bras. »
J’ai cité le dernier paragraphe, qui n’ajoute rien au portrait de Gau, pour donner une idée de l’art, du métier de Hans Fallada. Quand l’on sait que Gau et Schlicker se vouent la plus féroce des haines, ces quatre petites lignes toutes simples, toutes nues, ont une puissance d’évocation, une force d’expression incomparables. Il n’y a pas de doute, Hans Fallada est un grand artiste.
***
Un grand et véritable artiste, car son art est un art autonome, décalé des influences. Hans Fallada ne ressemble à personne. Il est lui-même totalement. Et on ne voit pas de qui on pourrait le rapprocher. L’objectivité du récit, un certain goût pour le pittoresque, de la poésie à l’état brut, un véritable génie de portraitiste : voilà les caractéristiques essentielles de Fallada et ses qualités majeures. Le plus qu’on pourrait lui reprocher serait de, parfois, un peu trop forcer l’humour dont il colore son récit. Mais ce .reproche, à la réflexion, est peut-être déplacé ; cette exagération dans le trait étant, je crois, nécessaire à l’atmosphère particulière des romans de Fallada…
Perruchot.
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JOD-220
Identifiant : ark :/12148/bpt6k7632109c
12:47 Publié dans Histoire, Recensions, Textes sur Hans Fallada | Lien permanent | Commentaires (0)






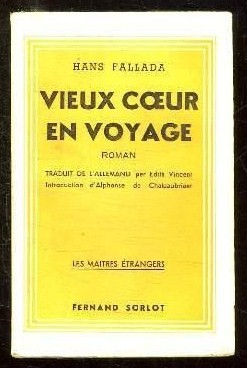
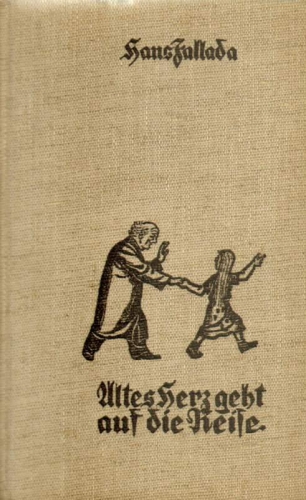
Les commentaires sont fermés.