07/12/2024
Recension: Le Buveur (septembre 1952)
Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, jeudi18 septembre 1952, N° 1307.
RENE LALOU
LE LIVRE DE LA SEMAINE
LE BUVEUR, par Hans Fallada
Lorsqu’on achève de lire Le Buveur (Der Trinker) dans la traduction sans aspérités de Lucienne Foucrault et Jean Rounault, on éprouve un choc en trouvant, après le mot « fin », cette note : « Ce livre a été écrit par Hans Fallada, du 6 au 21 septembre 1944, peu de temps avant sa mort. » J’avoue que ma première réaction fut un sentiment de stupeur, comme devant la découverte d’une étrange inhumanité. Comment le romancier allemand avait-il pu, en ces semaines où chaque communiqué annonçait un nouveau déplacement des forces armées sur la carte de l’Europe occidentale, s’isoler du monde extérieur et nourrir de sa substance, pendant plus de trois cents pages, l’existence fictive d’Erwin Sommer ?
Sans prendre à la lettre le « peu de temps avant sa mort », puisque Fallada vécut jusqu’au 5 février 1947, il est permis de conjecturer, comme une sorte de réponse, qu’il se sentait déjà frôlé par l’aile de l’ange exterminateur quand il rédigea cette confession d’Erwin Sommer qui est le minutieux et pathétique récit d’une descente vers la tombe. Si cette hypothèse est exacte, on ne s’étonnera plus que quinze fiévreuses journées d’envoûtement lui aient suffi pour décrire la lente mais inexorable déchéance à laquelle nous assistons dans Le Buveur(1).
En un certain sens, pourtant, ce titre risque de provoquer un malentendu. A l’âge de quarante ans. Sommer était si peu un ivrogne que le vin lui semblait avoir un goût âcre et que l’odeur de l’eau-de-vie l’écœurait. Ses voisins le tenaient pour un homme décent, un commerçant honnête et prospère, un excellent mari pour Magda qu’il avait épousée quatorze ans plus tôt. Mais tout cela n’est déjà plus qu’une façade trompeuse au moment où il commence son récit. Depuis quelques mois, il se sent envahi par une sorte d’insidieuse mollesse. Il a laissé péricliter ses affaires et l’Administration refuse de lui renouveler un contrat important. Dans le même temps, il lui semble que Magda se détourne de lui et ils ont leur première querelle sérieuse. Or, précisément, pour fêter leur réconciliation après cette dispute, il absorbe, ce soir-là, un verre et demi de vin rouge. Ainsi découvre-t-il le redoutable pouvoir de l’ivresse qui, pendant quelques heures d’illusion, vous transfigure l’univers. Il nous aurait paru invraisemblable qu’Erwin s’abandonnât sans résister à son nouveau vice si Fallada n’avait déployé tout son talent de romancier pour établir cette liaison entre les anxiétés de l’âge critique et le recours à la boisson chez un homme brusquement privé de tous ses appuis. Loin de se raccrocher à Magda, Erwin l’accuse maintenant de l’avoir tyrannisé durant des années et de l’avoir contraint à chercher un refuge dans la griserie. Frénétiquement, il se tourne vers une fille d’auberge qu’il adore et qu’il hait à la fois, qu’il invoque comme la reine du poison qui le fascine et le mène à sa perte. Quand il aura rencontré l’ignoble Lobedanz, ce mauvais génie va l’aider à précipiter les étapes de son autodestruction.
Tout ce long début de la confession est d’une force irrésistible. En revanche, j’ai été moins touché par les chapitres où Sommer décrit son séjour dans une maison de santé, d’un caractère disciplinaire. Non, certes, que Hans Fallada ait cessé d’y multiplier les scènes atroces, dont les acteurs sont de lamentables ou terrifiantes épaves humaines. Mais, dans cette partie, le roman tourne un peu trop au documentaire. Il reprend son affreuse rigueur quand Sommer raconte son procès en divorce, sa suprême entrevue avec Magda, sa rechute dans ses égarements, son internement définitif et son attente de la mort qu’il provoque en vidant les flacons où ont craché des tuberculeux. Les dernières pages où il se dépeint vivant déjà son agonie dans une extatique union avec sa « reine d’alcool » achèvent de donner au Buveur le sombre éclat d’un cauchemar hallucinant.
(1) Albin Michel.
10:42 Publié dans Recensions, Textes sur Hans Fallada | Lien permanent | Commentaires (0)





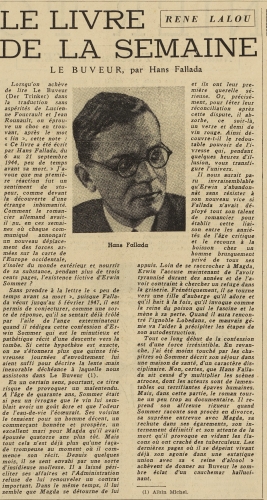
Les commentaires sont fermés.