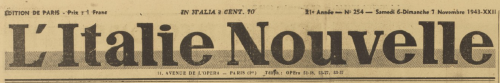07/12/2024
Recension : Gustave de Fer (novembre 1943)
L’Italie Nouvelle
ÉDITION DE PARIS
21e Année — N° 254 — Samedi 6-Dimanthe 7 Novembre 1943
== Courrier des Lettres ==
“Gustave de Fer” par Hans Fallada
Le grand romancier allemand Hans Fallada s’est fait l’historien de l’Allemagne dans les années qui ont suivi la guerre 1914-18. Il a su exprimer à travers ses romans tout le désespoir d’un peuple réduit à la misère, au chômage, aux convulsions politiques par l’inique traité de Versailles et aussi le courage, l’espoir, l’esprit d’entreprise de ce peuple pour surmonter sa défaite.
Plusieurs des romans d’Hans Fallada (Loup parmi les loups, Vieux cœur en voyage, etc...) ont connu en France ces dernières années un très grand succès. Volet une nouvelle traduction d’une des œuvres maîtresses de Hans Fallada : Gustave de Fer, qui comprend deux volumes : Infemo et Le Voyage à Paris.
Le premier volume ne ment pas à son titre car il dépeint l’enfer de la guerre de 1914-19 et de l’immédiat après-guerre à travers l’histoire d’une famille berlinoise dont le chef est un vieux cocher de fiacre, le père Hackendahl, surnommé Gustave de Fer à cause de l’intransigeance de son caractère.
Ancien sous-officier de cavalerie il entend mener sa famille comme son entreprise de fiacres : à la cravache. Mais cette méthode un peu sommaire d’éducation n’obtient pas les résultats qu’il espérait. L’aîné de ses fils, terrorisé par son père, obéit passivement et silencieusement jusqu’au jour où, encouragé par un officier à qui il a sauvé la vie dans les tranchées, il ose épouser la femme qu’il aime et donner son nom à son fils, contre la volonté de son père. Un autre fils sera attiré par la vie facile et prendra place parmi les profiteurs de la guerre et les spéculateurs de la paix. Une des filles, entraînée aux pires déchéances par un mauvais garçon, deviendra, à travers les plus horribles malheurs subis avec résignation, semblable à une héroïne de Dostoiewski. Seul le cadet Heinz demeurera dans la voie droite et difficile de l’honnêteté, mais il connaîtra les interminables et déprimantes périodes de chômage, jusqu’au jour où l’espoir lui apparaîtra sous la forme des premiers combats des Chemises Brunes. Et le livre s’achève sur une note d’espoir : tout un peuple se tourne vers un avenir qu’il veut construire courageusement.
La figure de Gustave de Fer domine le récit avec sa rudesse, son autorité têtue, son patriotisme qui le rendra clairvoyant. Écrit dans un style naturaliste qui ne redoute pas le détail mélodramatique, ce roman n’exclut pas l’humour et tout le récit du voyage en fiacre Berlin-Paris par le vieux Gustave de Fer ne manquera pas de pittoresque. On goûtera également la peinture des difficultés alimentaires des civils à Berlin pendant la guerre 14-18, du désordre des mœurs et des esprits qui suivirent la défaite et qui donne à ces pages vigoureusement réalistes un curieux accent d’actualité. Dans l’ensemble, ce grand roman peut prendre rang de témoignage et de document dans l’histoire du douloureux enfantement de l’Europe. (Albin Michel).
R.L
19:31 Publié dans Recensions, Textes sur Hans Fallada | Lien permanent | Commentaires (0)