22/11/2009
Le bon pré Krüselin (2eme Partie)
HANS FALLADA
LE BON PRE KRUSELIN ! A DROITE
(2eme Partie)
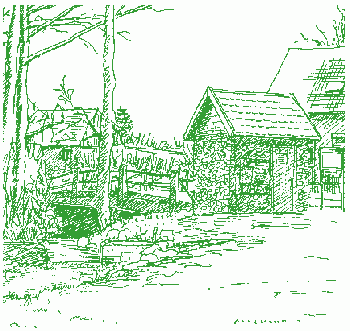
Une fois seuls, nous restâmes longtemps sans rien dire au pied de l’auge, regardant la truie et les petits qui tétaient. Au bout d’un instant, je remarquai qu’Ella avait glissé son bras sous le mien. Alors, je l’embrassai. Au fond, ce n’était pas désagréable du tout de l’embrasser ; elle avait de belles lèvres bien pleines et embrassait bien. Elle se serait de plus en plus contre moi. Mais soudain, je compris à sa respiration rapide qu’elle m’aimait vraiment et qu’elle avait tout fait pour m’avoir… cette idée me gâta tout et je la lâchai !
Elle sentit tout de suite ce qui se passait en moi et, debout à mes côtés, me regarda longuement. Mais je ne lui fis pas le plaisir de répondre à son regard et ne levai pas les yeux avant qu’elle ne demandât :
— Tu penses à Martha, n’est-ce pas ?
Je ne pus m’empêcher de l’examiner. Elle n’avait pas l’air fâché du tout, ni avide. Malheureuse plutôt. Elle faisait de la peine. Aussi dis-je : « Non, non ! » Mais elle ne me faisait pas vraiment pitié !
— Ne m’aimeras-tu jamais ? demanda-t-elle après un long moment.
Elle avait parlé si bas que j’aurais vraiment pu faire celui qui n’a rien entendu, mais je répondis néanmoins : « Si, si » et nous sortîmes ensemble de l’étable. De tout le reste de la journée, nous ne fûmes plus seuls.
Les Fingers étaient très pressés d’en finir. Au bout d’une semaine déjà les bans étaient publiés. Les bavardages ont dû marcher leur train, mais je ne m’en suis pas occupé. Je ne me suis d’ailleurs pas davantage occupé d’Ella. Quand j’étais obligé de passer devant chez elle avec les chevaux, je regardais de l’autre côté. Mais je n’allais pas non plus dans les environs de Martha. Durant des semaines, je ne la vis même pas. De préférence, je restais tout seul.
Ce fut une période bien pénible et je ne savais réellement pas comment m’occuper ! C’était encore à l’auberge que je me trouvais le mieux. Je laissais tout le travail au père et, dès le matin, je m’installais à boire. Il n’y avait personne dans la salle, la femme de l’aubergiste posait de la bière et des petits pains sur la table, l’aubergiste, lui, était aux champs. Les mouches volaient et bourdonnaient sur la table, il y avait toujours de petites flaques de bière ou de schnaps. Cela me convenait tout à fait. Auparavant, je n’entrais pour ainsi dire jamais à l’auberge, je n’aimais pas cela ! Pendant ces longues heures, à quoi pensais-je ? Je ne sais plus ! A rien du tout je crois, je restais assis là, complètement vidé, bon à rien et je buvais !
Les premières fois, mon père ou ma mère venait me chercher à l’auberge quand j’y restais trop longtemps. Père était très doux avec moi, jamais il ne se fâchait, bien que certainement il ait été profondément humilié de voir son fils devenir un buveur notoire. Il ne me demanda pas non plus de venir faucher le pré Krüselin. Il se rendait bien compte que je ne voulais pas en entendre parler. Aussi avait-il loué un homme de journée à ma place. Mais un jour que je demandais à père si je ne pourrais pas m’en aller pour toujours après la noce, puisqu’il était sûr maintenant d’avoir toujours le pré, il me répondit : « Non ! ça ne va pas ! »
Au bout de quelques semaines – le jour de la noce approchait – je compris qu’il me fallait revoir la Martha, je ne pouvais pas faire autrement. Mais je ne la trouvai nulle part et finalement j’appris par l’aubergiste qu’elle n’était plus du tout au village, mais qu’elle était partie à la ville comme femme de chambre dans un hôtel. A mon tour, je pris de l’argent et je m’en allais en ville.
J’arrivai assez tard le soir et je ne pus la voir. Mais le matin, elle entra dans ma chambre parce que j’avais sonné trois coups pour la femme de chambre, comme s’était inscrit sur l’affiche. En me voyant, elle devint blanche comme de la craie.
S’appuyant à la porte, elle dit au bout d’un moment :
— Oh ! mon cher Jochen, et ses larmes se mirent à couler !
Je lui dis « bonjour » et lui tendis la main. Et nous restâmes ainsi longtemps la main dans la main, et je sentis mon cœur et ma gorge se serrer. Si je l’avais pu, j’aurais volontiers pleuré moi aussi. Mais je ne le pouvais pas !
Cela dura très longtemps ; nous entendions sonner le timbre de l’hôtel, mais elle ne bougeait pas. Tout nous était égal. Enfin elle chuchota : « Mon Dieu, Jochen, tu n’aurais pas dû me courir après », et je l’attirai plus près de moi.
Et alors j’oubliai tout, j’avais ses yeux bruns foncés et ses sourcils noirs tout près de moi. Je sentais ses cheveux soyeux contre ma peau et je l’aimais de toutes mes forces, et j’étais en même temps furieux contre elle, parce qu’elle avait aussi que je devais faire ce que père voulait pour le pré Krüselin. Je l’attirais toujours plus près de moi et je la voulais ! Mais, d’un coup, elle se libéra.
— Tu te maries dans deux semaines, dit-elle. Crois-tu donc que j’accepterai que tu viennes chez moi quand tu en auras envie, avant comme après ?
— Une fois, une seule fois, maintenant, priais-je, mais elle ne m’écouta pas. Et comme je ne la laissais pas aller et que je cherchais toujours à la reprendre, tandis que le timbre de l’hôtel continuait à sonner, elle se fâcha. Je vis ses yeux changer d’expression, ils étincelaient, ses lèvres s’étaient pincées et, tout à coup, elle m’envoya son poing en pleine figure. « Tu bois, ma parole ! dit-elle. C’est parce que tu es gris que tu me veux, voilà tout ! »
— Je ne boirais plus jamais, Marthon, dis-je, mais je n’avais pas fini de parler que je recevais déjà son poing. Depuis longtemps personne ne m’avait frappé, depuis que j’allais à l’école, je crois. Pour un peu, je le lui aurais rendu, je voyais rouge, mais elle se libéra promptement et sortit en hâte de la chambre.
Elle ne revint plus ; je restais assis très longtemps à côté de la fenêtre en songeant que j’avais tout gâché. Jamais cela ne pourrait s’arranger, à cause de ce qui venait de se passer, à cause de tout en général. Même si nous renoncions maintenant au pré Krüselin, rien ne serait arrangé. Avec Martha non plus !
A la fin, j’ai sonné le garçon et je me suis fait monter tout une bouteille de cognac. Je lui ai demandé si on ne pouvait pas venir faire ma chambre. Il est parti et m’a envoyé Martha. Sous mes yeux, elle a dû faire chambre pendant que je restais tranquillement assis à la fenêtre, buvant mon cognac et la regardant. Elle ne m’a pas même jeté un coup d’œil. Quand elle a eu fini, je lui ai dit : « Merci bien », et je lui ai tendu un mark de pourboire. Elle l’a laissé sur la table, mais cela ne fait rien, elle savait bien que ce n’était pas pour essayer d’arranger l’affaire, mais bien en souvenir de certain soir auprès du lac, quand elle m’avait cédé. Car, si elle ne m’avait pas cédé alors, c’eût été moins dur, et bien plus facile à supporter. Mais à présent, c’est elle seule que je connais, et toutes les autres ne me disent rien !
Je voulais rester encore quelques jours, simplement pour la regarder sans rien dire, mais dans la nuit j’ai changé d’idée, et je suis rentré à la maison. Quinze jours après, j’étais marié. Mon mariage n’a pas si mal réussi après tout, parce qu’Ella a peur de moi. Et je ne bois plus jamais !
Mais parfois je n’y tiens plus, et je pars retrouver Martha. Bien qu’elle change souvent de place, je la retrouve toujours. Alors, je m’installe près d’elle et je la regarde. Nous n’avons plus jamais échangé un mot, mais elle n’est plus fâchée contre moi. Car, parfois, si cela va mal dans la cuisine avec ses maîtres, elle s’habille et sort en ville. Elle s’assied quelque part sur un banc et je m’installe sur un autre et, de temps en temps, nous nous regardons. Ce n’est pas beaucoup, mais cela aide. Jamais je n’aimerai une femme autant qu’elle. Au bout d’une heure ou deux, elle se lève et rentre à la maison. Avant d’entrer, elle se retourne encore une fois et me fait signe à travers la porte vitrée. Mais elle ne le fait jamais avant que la porte ne soit refermée entre nous. Elle comprend très bien que c’est très dur pour moi.
Quand elle a complètement disparu, je vais à la gare et je reviens à la maison.
Le pré Krüselin, à droite, est un excellent pré, et sans lui nous ne pourrions pas conserver la ferme. Mais, tout de même, je ne comprends pas, et maintenant que je l’ai écrit, je continue à ne pas le comprendre. J’avais toujours pensé que je finirais par oublier, mais je n’ai rien oublié du tout. C’est tout bonnement à n’y rien comprendre. Et il paraît que Müller Schmidtke aurait dit que je suis une poule mouillée de première qualité ; c’est bien possible, mais je ne vois vraiment pas comment j’aurais pu agir autrement. Nous avons à présent quatre enfants. J’avais toujours espéré que l’un d’eux ressemblerait à Martha. Mais non, ils sont tous comme Ella. Ainsi, je continue à rester tout seul. Père est devenu bien fragile !
Et d’écrire tout cela ne m’a servi à rien ! Aussi, demain, repartirai-je encore une fois à sa recherche. Je me suis promis de lui parler quand j’aurais cinquante ans. C’est une consolation, mais j’ai du temps devant moi, car je viens d’avoir trente-deux ans. Bonne nuit !
Traduction d’Edith Vincent.
Déjà publié dans Deux tendres agneaux,
Fernand Sorlot. Coll. Les maîtres étrangers, Paris, 1943.
16:31 Publié dans Textes de Hans Fallada | Lien permanent | Commentaires (0)




Les commentaires sont fermés.